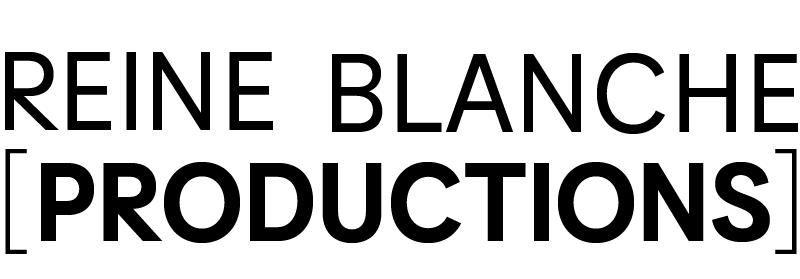La rencontre des trois hommes
Après une adolescence passée à lire et à voir défiler les grands esprits de l’époque dans le salon familial, Mathieu Lindon découvre l’excitation d’une culture autre, transgressive, facile, légère. C’est à la fin des années 1970 que Mathieu Lindon rencontre Michel Foucault. Dans son appartement, rue de Vaugirard, on écoute Mahler sous LSD, on parle littérature, amours, on joue même au frisbee en craignant quand même que le projectile heurte le Picasso accroché au mur. Pendant six ans, jusqu’à la mort du philosophe, en 1984, Lindon vit le plus clair de son temps dans cet appartement situé au huitième étage et bordé d’une longue baie vitrée qui tenait à la fois du nouveau monde, du dortoir, de la terre d’asile, de la barricade, du vaudeville, du paradis artificiel, de la maison de vacances et de l’université libre. Il prend l’habitude d’y habiter lorsque Foucault s’en absente, notamment pendant les longs mois d’été. Mais, dès son retour, il continue d’y venir, attiré par le rire claironnant et l’intelligence foudroyante de l’amphitryon comme un papillon par la lumière. Les innombrables soirées à l’acide, tout en visionnant « Citizen Kane » ou « la Pêche au trésor », des Marx Brothers, soude le petit groupe. Il y a toute une bande de jeunes écrivains qui squatte ; Foucault ne les reçoit pas en philosophe, c’est un ami, un confident. Parmi eux, Hervé Guibert. Chez Guibert, Foucault s’appelait Muzil. Il existait dans sa chair, jusque dans les coulures de sang séché sur le crâne qu’il rasait chaque matin. S’il prend corps chez Lindon, c’est à travers son appartement, mise en espace d’un mode de vie, où l’on peut entrer et sortir à sa guise, sans rendre de comptes, juste en profitant. La rue de Vaugirard est « une drogue à soi tout seul ». L’écriture, enthousiaste, excessive, dit cette griserie continue. Détournant le titre du livre d’Hervé Guibert (« À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie »), Lindon donne la plus belle preuve de gratitude à Michel Foucault en disant de lui: « L’ami qui m’a sauvé la vie. »
« Michel a dévié ma route. »
C’est là que Lindon a compris « ce qu’aimer veut dire ». C’est là qu’il a pleinement revendiqué son homosexualité, commencé à se rendre dans les backrooms et assumé ce que les méchantes langues disaient alors de lui: « pédé, drogué et ami de Michel Foucault ». C’est là qu’il a rencontré Hervé Guibert, l’auteur de « la Mort propagande » qui allait disparaître en 1991. C’est là qu’il a découvert, en même temps que la fête quotidienne, ses illusions et ses hallucinations, les premiers ravages du sida et vécu, à la manière d’un orphelin, l’agonie de Foucault. C’est là que, malgré son activité de journaliste au « Nouvel Observateur », il a fait le choix d’être écrivain et de ne rien cacher, dans ses livres, de ses obsessions. C’est là qu’il a fait le deuil d’une adolescence jugée « désastreuse », « calamiteuse », comme, avec l’adieu à Foucault, il tira un trait définitif sur sa jeunesse. C’est là enfin, dans cette seconde famille, plus vraie que la biologique, qu’il a été « élevé ». De cette époque tourbillonnante et du clan foucaldien de la rue de Vaugirard, Mathieu Lindon est le survivant un peu abasourdi. Il a en effet échappé au sida, qui a frappé dans la fleur de l’âge tant de ses amis d’alors. Il est sorti indemne d’une longue addiction aux drogues dures – LSD, héroïne, cocaïne, opium.
Mathieu est le fils cadet de Jérôme Lindon, le patron des Editions de Minuit, disparu en 2001. Ils avaient des relations compliquées, fondées sur l’idée que ni l’amour ni l’admiration ne doivent se dire. Alors qu’ils avaient la même passion de la littérature, leurs modes de vie étaient opposés: le père était dans la retenue et l’austérité, le fils dans l’exubérance et la liberté. Le premier avait hérité de son propre père, grand magistrat, une forme d’intransigeance ; le second allait laisser à sa sœur, Irène, le fauteuil directorial de la maison d’édition paternelle. Symbole de tout ce qui les unissait et les opposait, la publication, en 1983, chez Minuit, du premier livre de Mathieu Lindon, « Nos plaisirs ». Son père y consentit, mais à la seule condition qu’il fût signé d’un pseudonyme, trouvé d’ailleurs par Michel Foucault: Pierre-Sébastien Heudaux. C’est rue de Vaugirard qu’il a pris la mesure, après l’avoir étouffé et même combattu, de l’amour qu’il portait à son père, dont on lira ici la bouleversante lettre posthume laissée pour Mathieu: « Quand tu la liras, j’aurai disparu à mon tour, mais toi, tu auras encore beaucoup d’années à vivre. Aussi, la gratitude que je n’ai pas cru devoir manifester à mon père, je crois tout à fait opportun de te l’offrir à toi. J’espère seulement que j’aurai le sentiment, le moment venu, de ne t’avoir causé aucun tort grave, ce qui me donnera le droit de te demander, en t’embrassant, de m’oublier. »
Hervé Guibert
De 1979-1982, Guibert collabore à la revue Minuit, dirigée par Mathieu Lindon. En 1987, ils sont tout deux pensionnaires à la Villa Médicis jusqu’en 1989. En 1990, Hervé Guibert publiait A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie. Michel Foucault y devenait Musil, l’homme aux deux visages : une face diurne (un ami généreux) et une face nocturne (son goût pour le sado-masochisme). Le 29 juin 1984, sur la bière contenant le corps de Michel Foucault se trouve une gerbe de roses portant trois prénoms : Mathieu, Hervé, Daniel – c’est-à-dire Mathieu Lindon, Hervé Guibert et Daniel Defert. Daniel Defert est depuis longtemps le compagnon de Foucault. A sa mort, Foucault n’est pas un héros national. Plutôt un marginal célèbre, un réfractaire, à la manière de Gide. Comme lui, Foucault est discrètement enseveli dans un cimetière de campagne. Et comme Gide, sa fin est l’occasion d’une polémique. Les amis de Foucault s’indignent d’un entrefilet publié dans Libération pour démentir que Foucault soit mort du sida. Quelle honte y a-t-il à mourir du sida – c’est-à-dire à afficher son homosexualité ?, protestent-ils . « On lui vola sa mort, lui qui avait voulu en être le maître, et on lui vola jusqu’à la vérité de sa mort, lui qui avait été le maître de la vérité. Il ne fallait surtout pas prononcer le nom de la lèpre… », écrit Hervé Guibert, dans une nouvelle, Les Secrets d’un homme, figurant dans le recueil Mauve le vierge, publié en 1988. Quatre ans plus tard, Guibert, lui aussi, meurt du sida. Mais lui, ne s’est pas fait voler sa mort. Il l’a orchestrée, l’a mise en scène.
Hervé Guibert, le photographe 



Entretien du 09/01/11 par Nelly Kaprièlian (les Inrockuptibles)
Ce qu’aimer veut dire de Mathieu Lindon (P.O.L)
Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour écrire autour de votre amitié avec Michel Foucault, autour de votre père, aussi ?
Mathieu Lindon J’ai eu, enfant et adolescent, une position spéciale où je n’ai aucun mérite : celle de côtoyer des écrivains tels que Beckett ou Robbe-Grillet, tout simplement parce que j’étais le fils de l’éditeur Jérôme Lindon. Je me suis toujours préservé de raconter ces histoires. En revanche, mon amitié avec Michel Foucault, j’y étais en partie pour quelque chose. Dans les deux cas, j’espère que j’ai su rester digne en relatant certains faits dans ce livre. Ce qui m’y a enfin autorisé, c’est peut-être que Michel Foucault est mort depuis plus de vingt-cinq ans et mon père depuis près de dix.
Cela faisait très longtemps que je voulais parler de l’appartement de Michel Foucault dans un livre qui se serait intitulé Rue de Vaugirard. Je n’avais pas envie de parler de mon adolescence mais de ma jeunesse qui d’une certaine manière est très identifiable en termes temporels : elle débute plus ou moins quand je deviens ami avec Michel et se finit à sa mort. L’appartement symbolise cette jeunesse.
Au début, je voulais faire une autobiographie sans parler de moi mais des autres autour de moi, un peu comme un narrateur d’Henry James qui a un rôle primordial et en même temps secondaire, sans qui il n’y aurait pas le livre mais qui n’en est pas le héros. Je suis sans doute devenu, au fur et à mesure, un personnage plus important que je ne le pensais et c’était pénible.
A la fin, je n’en pouvais plus, j’avais une sorte de dégoût simplement à écrire « je ». Il fallait que je reste à ma place mais, pour y rester, encore fallait-il la trouver par rapport à Michel Foucault et à mon père. J’ai eu du mal, j’ai abandonné mon travail un moment, puis en cherchant un livre, je suis tombé sur un texte de Willa Cather, un auteur américain que j’adore, dont l’héroïne est la nièce de Flaubert, Caroline, que Cather rencontre en 1930. Ce texte m’a bouleversé. Je me suis remis à écrire.
Au départ, mon père ne devait pas être aussi présent mais un des effets de l’amitié de Michel dans ma vie est de m’avoir rééquilibré. Alors il fallait bien montrer les deux côtés. Mon père faisait toujours peser un certain poids sur moi en tant que père, et un autre culturellement par ce qu’il représentait. Pour me rééquilibrer, il me fallait quelqu’un de l’envergure de Michel du point de vue culturel.
Il y a un autre personnage important dans votre livre : la littérature…
C’est vraiment en lisant le texte de Willa Cather que j’ai compris ma place dans le dispositif, en m’identifiant en partie à Caroline, à qui Flaubert avait toujours écrit. Plus tard, je me suis aussi identifié à Céleste Albaret, la gouvernante de Proust, car j’ai moi aussi été pris dans ce monde-là, ce monde de la littérature.
Quand je raconte que, lorsque je lis le livre de Robbe-Grillet où il parle de sa mère, j’entends encore résonner la vraie voix de celle-ci, c’est vrai : j’ai été pris dans la littérature, la littérature a joué un rôle dans ma vie par les livres mais par la vie même. Pendant longtemps, donc, je n’ai pas voulu en parler. Plus jeune, je voulais devenir écrivain et être reconnu pour mon talent, non pas parce que j’avais connu ces personneslà.
En vieillissant, je me suis dit qu’il serait généreux de donner aux autres quelque chose que j’ai eu, moi, par chance. Mais ça a été difficile. Michel, c’était une relation différente, que je me sentais plus de raconter tellement c’est dans ma vie, tellement ça a façonné ma jeunesse et ma vie.
On a l’impression que vous mettez sans cesse en parallèle Michel Foucault et votre père, dans leur relation à vous.
Je compare l’effet qu’ils ont eu sur moi. Michel est comme un père pour moi, au sens de créateur. J’avais besoin de rééquilibrer les choses dans ma vie car j’étais trop sous l’emprise de mon père. En plus, il aimait user de son poids culturel. Je cite la phrase d’un auteur que m’avait répétée Foucault : « En lui parlant, on a l’impression de passer devant un tribunal où siègent
Beckett, Robbe-Grillet, Duras, Deleuze, Simon, Bourdieu, Pinget… » Moi aussi, j’avais cette vision. Mais au fond, même si le contexte de ce que je raconte peut sembler exceptionnel, ce qui s’y joue est assez ordinaire, comme me l’a fait comprendre Christine Angot un jour où je lui parlais de mes problèmes avec le livre : c’est un père, son fils et un ami. D’une certaine manière, le père a perdu d’avance puisque son poids est structurel, suscite d’une façon ou d’une autre une résistance.
A une époque, tout ce que je pouvais découvrir qui venait de Michel, j’en étais fier, et tout ce que je pouvais découvrir qui venait de mon père m’agaçait. Cette relation m’a permis de me déprendre d’une partie de l’influence paternelle, de comprendre ce qu’aimer veut dire, ce qu’un amour fait peser. L’amour de mon père pèse, l’amitié de Michel ne pèse pas du tout. Elle est la légèreté même, un envol permanent.
Peut-être que ce qui différencie ces deux hommes se joue au niveau du pouvoir. Vous dites que votre père aimait son pouvoir, alors que Michel Foucault, qui a travaillé sur le pouvoir, n’en faisait pas usage.
Il connaissait tellement bien les relations de pouvoir qu’il savait très bien comment ne pas y participer. Il avait une telle puissance que c’est cela qui l’intéressait plus que le pouvoir. Il était professeur au Collège de France mais il n’est certes jamais devenu un mandarin, avec une armée de disciples.
Que vous a transmis Michel Foucault ?
J’ai compris, bien après, qu’il m’avait transmis cette possibilité de réinventer des vies. J’ai eu l’impression d’apprendre de lui quelque chose sans m’en rendre compte, et en particulier d’avoir des relations amoureuses sans en être conscient. Grâce à Michel, j’ai pu être amoureux sans me rendre compte que cette relation qu’on était deux à mener, avec lui ou avec d’autres, était une relation amoureuse. Et cela évitait que mille éléments entravent cette relation. Il a allégé certaines choses et permis l’invention d’autres, permis d’aller dans n’importe quel chemin, où je n’aurais pas songer à aller, et d’y aller sans réfléchir.
J’ai toujours pensé que, plus jeune, souvent, j’étais malheureux par convention, que des choses qui me faisaient du mal n’avaient au fond aucune raison de m’en faire, comme la jalousie, par exemple. Comme si l’amour était quelque chose de défini, comme s’il n’y avait qu’à cocher des cases pour savoir si on est dans l’amour. En inventant des relations, à partir du moment où je n’avais plus l’ambition de les faire tenir dans une case ou une définition possible, je n’en ai retiré que des bénéfices.
J’associe aussi cela à l’acide. Je me disais, en plein acide : c’est horrible, il y a plein de gens qui ne vont jamais connaître ça parce qu’ils auront entendu dire qu’il ne faut pas en prendre. Mon père, que j’aime tant et qui est une personne tellement à l’affût de choses intéressantes, si je lui avais apporté des acides, il ne les aurait pas pris. Il croit que c’est mieux de se priver de ça alors que c’est quand même une chose magique.
Moi-même, j’ai été à deux doigts de ne jamais en prendre alors que ça m’a aidé énormément. Je ne fais certes pas l’apologie de la drogue mais moi, à une certaine époque, dans certaines circonstances, le LSD m’a fait le plus grand bien. Je sais aussi le mal que ça a fait à d’autres et que ça a failli me faire à moi, en définitive. Mais, à un moment, ça m’a fait découvrir qu’il y avait d’autres vies possibles, ça m’a ouvert l’esprit.
Ce livre porte sur la façon dont une rencontre peut changer une vie ?
Ce livre porte sur Michel comme l’ami qui m’a sauvé la vie. D’une manière inattendue et inespérée, du moins pour moi, je m’en suis sorti et j’ai écrit ce livre dans la reconnaissance. J’avais beaucoup de mal à rencontrer qui que ce soit. Et j’ai rencontré des êtres admirables. Cette jeunesse-là, que j’ai eue grâce à Michel, m’a permis de ne pas rester les vingt années suivantes tout seul à lire dans ma chambre. Ça m’a aussi sauvé d’une vie de soumission ou de révolte que, tel que je me connais, j’aurais menée de façon obsessionnelle. J’ai pu trouver une place à distance qui a fait l’affaire.
Entre vous, Hervé Guibert et Foucault, on sent une générosité, une bienveillance qui circule, et aussi une vraie tendresse. Quand Foucault, par exemple, se rend dans des bars SM, il vous dit » ce n’est pas pour vous, mes lapins ».
Michel m’avait longuement parlé d’Hervé, et vice versa, et il savait très bien ce qu’il faisait. Il a eu la générosité de nous faire nous rencontrer chez lui. A un moment, il ne nous invitait plus ensemble parce qu’on y faisait trop les cons et ça finissait par l’agacer. C’est dans cet appartement de la rue de Vaugirard que j’ai rencontré tous mes amis. Je faisais mon sac et on y allait en vacances. J’y allais quand il était là aussi, et au fil des années, quand il n’était pas là, on s’y installait même pour des temps très courts. C’était comme un endroit de conte de fées.
Quand j’ai connu Michel, j’avais 23 ans, j’avais l’impression d’être en retard, même pour la jeunesse. Même l’acide, c’était un truc de la décennie d’avant, il y avait un aspect démodé. Dans cet appartement, il y a eu des êtres magiques, des relations magiques ; la présence de Michel permettait cela car on avait toute confiance. On savait qui il était, son intelligence et sa bonté sautaient aux yeux. C’est la chose qui m’émeut le plus : sa bonté, une affection si inventive.
Dans cette affaire, je n’étais pas le héros mais le récipiendaire. On s’en rendait bien compte, qu’il nous voulait du bien, donc on avait confiance. C’est vrai que j’aimerais bien, moi aussi, à ma mesure, donner ça à des êtres. Quelque chose m’est tombé dessus de l’ordre de « la responsabilité de bonté ».
Comment écrit-on un livre qui engage autant d’êtres connus ?
Je voulais écrire sans faire de mal à personne mais bon, on ne sait jamais ce qui peut blesser quelqu’un dans un livre. Je ne me suis censuré à aucun moment, mais à aucun moment non plus je n’ai eu à me dire « tant pis, c’est de la littérature, on y va », ça ne s’est pas posé en ces termes. Je me suis gardé de mettre des phrases dans la bouche de Michel Foucault ou de mon père qui puissent servir à un biographe.
Je parle de ce qu’ils m’ont dit au style indirect pour qu’on puisse ne l’utiliser éventuellement qu’à travers moi. Et puis ce que j’ai en tête n’est que ce que je me souviens d’avoir compris, peut-être n’est-ce pas la phrase que l’un ou l’autre m’a exactement dite.
Votre père était très lié à Samuel Beckett, comme un parallèle de votre amitié avec Foucault…
Au début, je raconte ce que me dit mon père quand Samuel Beckett, qui fut vraiment la grande personne de sa vie, meurt. Il me dit : « Tu sais ce que c’est », m’élevant à un niveau semblable parce que j’ai souffert de la mort de Michel. Je trouve cela d’une grande générosité. Mon père a certes été très ami avec Alain Robbe-Grillet dans sa jeunesse puis avec Gilles Deleuze à la fin de sa vie, mais Beckett, c’était particulier du fait qu’il avait dix-neuf ans de plus que mon père. Il avait une affection folle pour Sam. Il lui devait sa vie d’éditeur, à partir de Molloy.
Vous montrez que votre père était un éditeur avant tout, qui mettait la littérature au-dessus de tout. N’était-ce pas difficile à vivre pour un fils ?
Oui, ça le constituait. On ne voyait à peu près que des écrivains à la maison, peu de gens venaient dîner mais ceux qui venaient, c’étaient les auteurs de Minuit. Il y a cette histoire bouleversante quand je raconte le moment où Hervé Guibert propose par mon intermédiaire à mon père son livre A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie. La première phrase du livre est « J’ai eu le sida pendant trois mois ». Mon père est tellement éditeur qu’il est le seul lecteur à ne pas s’être rendu compte que le narrateur est malade du sida, il était tellement un lecteur d’exception qu’il a pu passer à côté de ça. Ça dit quelque chose de nos rapports à nous aussi.
Quand il lit un de mes premiers livres, à tort ou à raison, il me dit que je suis quelqu’un de bien, comme s’il avait eu besoin d’un livre pour s’informer. C’est étonnant comme la littérature était le médiateur de tout. Si je n’avais pas aimé les carottes râpées, il aurait peut-être fallu que je l’écrive dans un livre pour qu’il le sache. Mais j’aime beaucoup les carottes râpées. C’est grâce à Robbe-Grillet que j’ai publié mon premier roman. Mon père le lui a donné à lire sans lui dire de qui était le manuscrit et il a été très content de l’avis favorable d’Alain. Et puis Alain avait un côté un peu pervers et s’amusait de cela, me parlait volontiers de garçons. Comme mon père et comme Michel, il a toujours représenté pour moi quelque chose de la jeunesse.
Votre livre dit aussi l’importance du temps dans une vie.
Envisager le temps comme un capital dans les relations m’a donné une relative assurance. Beaucoup de mes erreurs sont venues d’un manque d’assurance. Et quand j’en ai eu un peu plus, d’assurance ou de fatalisme, les choses se sont mieux passées. A la fin avec Michel, on parlait beaucoup du rapport désirplaisir et mon premier livre traitait de cela. J’ai pu avoir le plaisir de ces amitiés, comme un temps celui de la drogue, sans en avoir eu le désir tellement ça relevait pour moi d’un autre monde dont je ne connaissais tellement rien que je ne pouvais même pas en être curieux.
L’époque était dans le mode du désir et, quand je lui ai dit que le titre que j’avais en définitive trouvé pour mon premier roman était Nos plaisirs (publié sous le pseudonyme de Pierre-Sébastien Heudaux en 1983 chez Minuit – ndlr), il était enchanté. Je ne le savais pas encore mais L’Usage des plaisirs est le titre du premier de ses deux livres alors à venir.